|
Une vieille tradition nous parle de Veríssimo, Máxima e Júlia,
comme martyres de
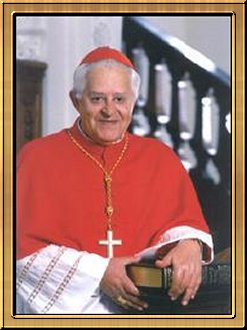 Lisbonne,
lors de la persécution déclenchée par Dioclétien (fin du IIIe siècle,
début du IVe). Ce qui est certain en tout cas, c’est qu’un demi
siècle plus tard, nous avons la certitude qu’un diocèse existait et que son
premier évêque connu était Potâmio, lequel est intervenu dans les polémiques
doctrinales qui opposaient alors les chrétiens : l’arianisme. Lisbonne,
lors de la persécution déclenchée par Dioclétien (fin du IIIe siècle,
début du IVe). Ce qui est certain en tout cas, c’est qu’un demi
siècle plus tard, nous avons la certitude qu’un diocèse existait et que son
premier évêque connu était Potâmio, lequel est intervenu dans les polémiques
doctrinales qui opposaient alors les chrétiens : l’arianisme.
Au cours du Ve
siècle les barbares arrivèrent jusqu’à l’extrémité de l’Europe et, sous la
monarchie wisigothe, les évêques de Lisbonne participèrent à divers conciles,
dont celui de Tolède. Comme il advînt par tout ailleurs, il est fort probable
que la décentralisation du culte, de la ville vers les campagnes tout autour, ce
qui fut à l’origine des paroisses rurales.
Du début du VIIe siècle jusqu’au milieu de XIIe,
Lisbonne fut sous la domination musulmane. Nous ne connaissons le nom d’aucun
des évêques de cette longue période, mais nous sommes sûrs que des chrétiens
continuèrent d’exister, aussi bien en ville que dans les campagnes
environnantes.
La preuve en est que lors de la prise de Lisbonne aux
maures, en 1147, un évêque « moçarabe » (chrétien sous la domination musulmane)
y vivait.
Après la conquête de la ville, le diocèse fut restauré et à
sa tête fut placé un évêque anglais, Dom Gilbert, venu avec les croisés.
Toutefois, le diocèse était dépendant de l’archidiocèse de Saint-Jacques de
Compostelle, jusqu’à la fin du XIIIe siècle.
On construisit une Cathédrale, à l’endroit où se levait jadis
une mosquée, et peut-être avant, la cathédrale wisigothe.
La Cathédrale avait son chapitre, lequel appuyait et aidait
son évêque, et supportait l’école capitulaire. Ce fut dans cette école — selon
une ancienne tradition — que saint Antoine de Lisbonne (Padoue) aurait fait ses
premières études, à la fin du XIIe siècle.
Outre la Cathédrale et les paroisses qui, rapidement se sont
établies, à partir peut-être d’anciennes communautés « moçarabes », Lisbonne vît
se lever, à l’initiative du premier roi du Portugal, Dom Alphonse Henriques —
fils d’Henri de Bourgogne — le monastère de Saint Vicente de Fora
(parce
qu’étant construit en dehors des remparts).
Ce monastère fut un important centre culturel et ce fut là
que saint Antoine accomplit ses études supérieures.
Saint Vincent avait été martyrisé à Valence (Espagne) au IVe
siècle, et ses reliques furent ensuite l’objet d’une très grande vénération de
la part des « moçarabes » qui habitaient surtout le sud, le cap qui porte
aujourd’hui son nom.
Dom Alphonse Henriques ramena ces reliques à Lisbonne et les
déposa dans la Cathédrale.
En 1289 l’évêque Dom Domingos Jardo fonda le collège des
saints Paul, Éloi et Clément, pour l’enseignement des canons et de la théologie.
Peu après, avec des intermittences jusqu’au XVIe
siècle, Lisbonne disposa d’une Université fondée par le roi Dom Dinis (époux de
sainte Élisabeth), avec l’appui du clergé. Cette université n’enseigna la
théologie qu’à partir de du XVe siècle, car cette discipline n’était
apprise alors que dans les monastères des dominicains et des franciscains,
couvents construits pendant le XIIIe siècle.
Ce fut en ce même XIIIe siècle, en 1276 que naquit
à Lisbonne Pedro Julião, illustre médecin qui étudia et enseigna à Paris, avant
de devenir pape sous le nom de Jean XXI.
En 1393 Lisbonne fut élevée à métropole et D. João Anes fut
son premier archevêque. A cette métropole furent associées plusieurs diocèses du
centre et du sud du pays, auxquelles, le siècle suivant, vinrent se joindre
aussi les nouveaux diocèses d’outre-mer.
Au XVIe siècle, le cardinal Dom Henrique — qui
deviendra roi un peu plus tard — s’employa activement à mettre en pratique les
résolutions du Concile de Trente. On lui doit, entre autres initiatives, la
fondation du Séminaire diocésain de Sainte-Catherine, en 1566.
Ce furent des temps d’une intense vie religieuse, nourris par
un grand nombre de congrégations religieuses et d’autres associations de piété
et de charité, liées aux monastères, couvents et paroisses : la première
Miséricorde fut fondée à Lisbonne en 1498, dans une chapelle du cloître de la
Cathédrale de Lisbonne.
Dès la fin du XVe siècle les divergences
religieuses n’étaient pas permises dans le pays, mais la mission d’outre-mer —
si magnifiquement évoquée au monastère des Jerónimos — demandait constamment des
ouvriers : entre autres, Lisbonne a donné pour la mission Jean de Brito, pour
l’Inde ; le Père António Vieira pour le Brésil, tout deux Jésuites du XVIIe
siècle.
En 1716, le pape Clément XI éleva la chapelle royal au rang
de basilique patriarcale ; alors l’ancienne diocèse fut partagée en deux
jusqu’en 1740, année qui vit sa réunification.
Depuis, et jusqu’à nos jours, seize patriarches se sont
succédés à la tête de l’ancienne cité, de D. Tomás de Almeida à D. José
Policarpo : les patriarches étant toujours élevés au cardinalat lors du prochain
consistoire suivant leur nomination.
Après le terrible et dévastateur tremblement de terre de 1755
— la ville fut presque entièrement détruite — il fallut remodeler le tissu
paroissial, construire d’autres églises ; ce fut le patriarche d’alors, Dom
Fernand de Sousa e Silva qui s’y employa, dès 1780, avec succès, aidé, il est
vrai, par les libéralités de Dona Maria I, reine du Portugal. Ce fut elle qui
fit construire la Basilique de l’Étoile, consacrée au Sacré-Cœur de Jésus.
Après les grandes perturbations liées aux invasions
françaises et aux luttes libérales, il fallut encore réorganiser : ce fut
l’œuvre du patriarche Dom Guilherme Henriques de Carvalho, vers le milieu du XIXe
siècle.
Puis, ce furent les temps délicats et troublés de
l’implantation de la république maçonnique, avec toutes les conséquences qui en
résultèrent, l’évêque de Porto, Dom António Barroso, étant l’exemple le plus
éloquent de cette période sournoise.
A partir de 1929, le patriarche Dom Manuel Gonçalves
Cerejeira consolida la vie diocésaine, suscitant les vocations sacerdotales et
fondant de nouveaux séminaires : Olivais (1931), Almada (1935) et Penafirme
(1960) ; multipliant les paroisses et encourageant l’apostolat des laïcs.
Dom António Ribeiro, son successeur, continua son œuvre, dans
les termes demandés par le Concile Vatican II.
Le 25 avril, la révolution des œillets n’apporta aucun
changement notable.
En 1975 les diocèses de Setubal et Santarém, furent détachés
du patriarcat de Lisbonne et, en 1984, fut fondé le Séminaire de Caparide.
Dom José Policarpo succéda, au mois d’octobre 1998 à Dom
António Ribeiro et l’une de ses premières actions fut de transférer les services
diocésains au monastère « mythique » de Saint Vicente de Fora, dont nous avons
déjà parlé.
Dom Manuel Clemente
et
Alphonse Rocha
|
