|
Daniel Comboni: un fils de paysans
pauvres qui devint le premier Évêque de l'Afrique Centrale et un des plus grands
missionnaires de l'histoire de l'Église.
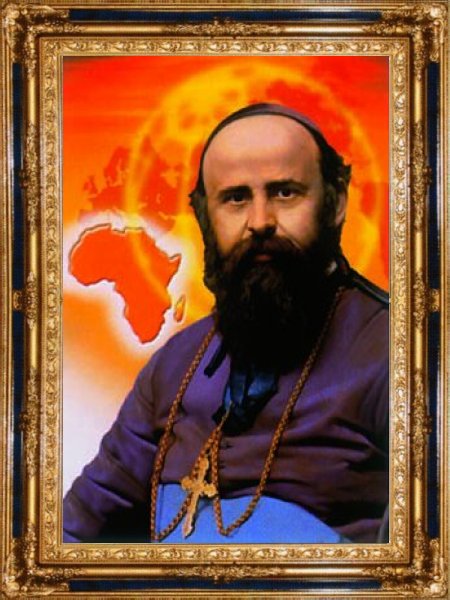 Quand
le Seigneur décide d'intervenir et qu'il trouve une âme généreuse et disponible,
on peut voir des choses grandes et nouvelles se réaliser. Quand
le Seigneur décide d'intervenir et qu'il trouve une âme généreuse et disponible,
on peut voir des choses grandes et nouvelles se réaliser.
Fils «unique» - des parents
saints
Daniel Comboni naît à Limone sul
Garda (Brescia - Italie) le 15 mars 1831, dans une famille de paysans au service
d'un riche seigneur de la région. Son père Louis et sa mère Dominique sont très
attachés à Daniel, le quatrième de huit enfants, morts presque tous en bas âge.
Ils forment une famille unie, riche de leur foi et de valeurs humaines, mais
pauvre en moyens économiques. C'est justement la pauvreté de la famille Comboni
qui pousse Daniel à quitter son village pour aller fréquenter l'école à Vérone,
auprès de l'Institut de l'Abbé Nicolas Mazza.
Au cours de ces années passées à
Vérone, Daniel découvre sa vocation au sacerdoce, termine ses études de
philosophie et de théologie et surtout il s'ouvre à la mission de l'Afrique
Centrale, attiré par le témoignage des premiers missionnaires de l'Abbé Mazza
qui reviennent du continent africain. En 1854, Daniel Comboni est ordonné prêtre
et trois ans après il part pour l'Afrique avec cinq autres missionnaires de
l'Abbé Mazza, avec la bénédiction de sa mère Dominique qui lui dit: «Vas,
Daniel, et que le Seigneur te bénisse».
Au cœur de l'Afrique - avec
l'Afrique dans son cœur
Après quatre mois de voyage,
l'expédition missionnaire dont Comboni fait partie arrive à Khartoum, la
capitale du Soudan. Le choc du contact avec la réalité africaine est énorme.
Comboni se rend compte tout de suite des difficultés que sa nouvelle mission
comporte. Les fatigues, le climat difficile, les maladies, la mort de nombreux
et jeunes compagnons missionnaires, la pauvreté et la situation d'abandon des
gens, le poussent toujours davantage à continuer et à ne pas quitter ce qu'il
avait commencé avec tant d'enthousiasme. De la mission de Sainte Croix, il écrit
à ses parents: «Nous devrons nous fatiguer, transpirer, mourir; mais la pensée
qu'on transpire et qu'on meurt par amour de Jésus-Christ et du salut des âmes
les plus abandonnées du monde est trop douce pour nous faire désister de cette
grande entreprise».
En assistant à la mort en Afrique
d'un jeune compagnon missionnaire, Comboni, au lieu de se décourager, se sent
encore plus intérieurement confirmé dans sa décision de continuer sa mission:
«Ou l'Afrique ou la mort».
Et c'est toujours l'Afrique et ses
peuples qui poussent Comboni, une fois revenu en Italie, à mettre au point une
nouvelle stratégie missionnaire. En 1864, alors qu'il était en prière sur la
tombe de S. Pierre à Rome, Daniel est frappé par une illumination fulgurante qui
le pousse à élaborer son fameux «Plan pour la régénération de l'Afrique», un
projet missionnaire qui peut être synthétisé en une phrase: «Sauver l'Afrique
par l'Afrique», fruit de sa confiance sans limites dans les capacités humaines
et religieuses des peuples africains.
Un Évêque missionnaire
original
Au milieu de beaucoup de
difficultés et d'incompréhensions, Daniel Comboni comprend que la société
européenne et l'Église catholique sont appelées à prendre davantage en
considération la mission de l'Afrique Centrale. Dans ce but, il se consacre à
une animation missionnaire infatigable dans tous les coins de l'Europe,
demandant une aide spirituelle et matérielle pour les missions à des Rois, des
Évêques, des riches et des gens simples et pauvres. Et comme instrument
d'animation missionnaire il fonde une revue missionnaire, la première en Italie.
Sa foi inébranlable dans le
Seigneur et dans l'Afrique le conduit à fonder, respectivement en 1867 et en
1872, les Instituts masculin et féminin de ses missionnaires, connus plus tard
sous le nom de Missionnaires Comboniens et de sœurs Missionnaires Comboniennes.
Comme théologien de l'Évêque de
Vérone, il participe au Concile Vatican I, faisant souscrire à 70 Évêques une
pétition en faveur de l'évangélisation de l'Afrique Centrale (Postulatum pro
Nigris Africæ Centralis).
Le 2 juillet 1877, Comboni est
nommé Vicaire Apostolique de l'Afrique Centrale; un mois après il est consacré
Évêque: c'est la confirmation que ses idées et ses actions, jugées par beaucoup
de personnes trop courageuses ou même folles, sont bien efficaces pour l'annonce
de l'Évangile et la libération du continent africain.
Au cours des années 1877-1878, avec
ses missionnaires hommes et femmes, il souffre dans son corps et dans son esprit
de la tragédie d'une sécheresse et d'une famine sans précédents, qui réduisent
de moitié la population locale et épuisent le personnel et l'activité
missionnaires.
La croix, amie et épouse
En 1880, avec toujours le même
courage, Monseigneur Comboni revient en Afrique, pour la huitième et dernière
fois, à côté de ses missionnaires, décidé à continuer la lutte contre la plaie
de l'esclavage et à consolider l'activité missionnaire avec les africains
eux-mêmes. L'année suivante, éprouvé par la fatigue, les morts fréquentes et
récentes de ses collaborateurs, l'amertume des accusations et des calomnies, le
grand missionnaire tombe malade. Le 10 octobre 1881, à l'âge de cinquante ans,
marqué par la croix qui jamais ne l'a abandonné comme une épouse fidèle et aimée,
il meurt à Khartoum, parmi ses gens, conscient que son œuvre missionnaire ne
mourra pas. «Je meurs, dit-il, mais mon œuvre, qui est oeuvre de Dieu, ne mourra
pas».
Daniel Comboni a vu juste. Son
œuvre n'est pas morte; au contraire, comme toutes les grandes œuvres qui «naissent
aux pieds de la croix», elle continue à vivre grâce au don de leur propre vie
que tant d'hommes et de femmes vivent, eux qui ont décidé de suivre Comboni sur
le chemin de la mission ardue et enthousiasmante parmi les peuples les plus
pauvres de la foi et les plus abandonnés de la solidarité humaine.
Les dates fondamentales de sa
vie
— Daniel Comboni naît à Limone sul
Garda (Brescia - Italie) le 15 mars 1831.
— Il consacre sa vie à l'Afrique
(1849), en réalisant un projet qui le conduit plusieurs fois à risquer sa vie au
cours d'expéditions missionnaires exténuantes dès 1857, l'année où il part pour
la première fois pour l'Afrique.
— Le 31 décembre 1854, année de la
proclamation de l'Immaculée Conception de Marie, il est ordonné prêtre par le
bienheureux Giovanni Nepomuceno Tschiderer, évêque de Trente.
— Dans la confiance que les
africains deviendront eux‑mêmes protagonistes de leur propre évangélisation, il
prépare un projet qui a le but de «sauver l'Afrique par l'Afrique même» (Plande
1864).
— Fidèle à sa devise: «Ou l'Afrique
ou la mort», malgré les difficultés, il poursuit son projet en fondant en 1867
l'Institut des Missionnaires Comboniens.
— De manière prophétique, il
annonce à l'Église toute entière, en particulier en Europe, que l'heure du salut
des peuples de l'Afrique est arrivée. Pour cela, même s'il est un simple prêtre,
il n'hésite pas à se présenter au Concile Vatican I pour demander aux évêques
que chaque église locale soit engagée dans la conversion de l'Afrique (Postulatum,
1870).
— Avec un courage hors du commun à
l'époque, le premier, il envoie des sœurs Missionnaires dans la mission de
l'Afrique Centrale et en 1872 il fonde son Institut de sœurs exclusivement
consacrées aux missions: les sœurs Missionnaires Comboniennes.
— Pour les africains, il dépense
toutes ses énergies, et il se bat pour l'abolition de l'esclavage.
— En 1877 il est consacré Évêque et
nommé Vicaire Apostolique de l'Afrique Centrale.
— Épuisé par les fatigues et les
croix, il meurt à Khartoum (Soudan), le soir du 10 octobre 1881.
— Le 26 mars 1994 est reconnue
l'héroïcité de ses vertus.
— Le 6 avril 1995 est reconnu le
miracle opéré grâce à son intercession en faveur d'une jeune fille
afro-brésilienne, Maria José de Oliveira Paixão.
— Le 17 mars 1996 il est béatifié
par Jean-Paul II dans la basilique Saint-Pierre.
— Le 20 décembre 2002 est reconnu
le second miracle opéré grâce à son intercession en faveur d'une mère musulmane
du Soudan, Lubna Abdel Aziz.
— Le 5 octobre 2003 il est canonisé
par Jean-Paul II dans la basilique Saint-Pierre. |
