|
«L'Église est
l'œuvre du Christ, l'œuvre par laquelle Il se prolonge, se réfléchit
et par
laquelle Il est toujours présent dans le monde. Elle est son Épouse
à laquelle Il s'est entièrement offert... Ainsi, si Dieu a aimé
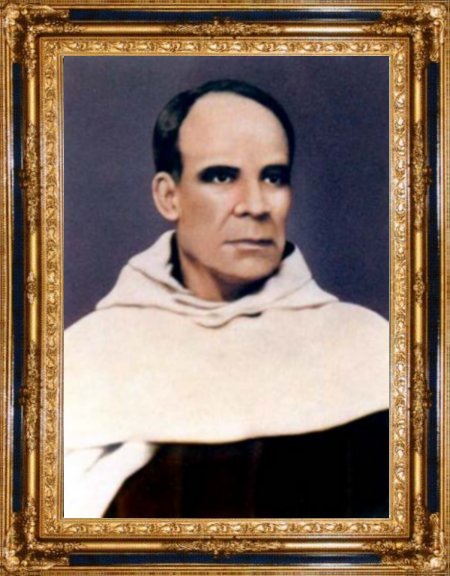 l'Église
au point de lui sacrifier Sa vie, cela signifie qu'elle est digne
aussi de notre amour» (Jean-Paul II, 3 mars 1983). Le 24 avril 1988,
le Pape Jean-Paul II a béatifié Francisco Palau, un religieux épris
d'un amour exceptionnel de l'Église. l'Église
au point de lui sacrifier Sa vie, cela signifie qu'elle est digne
aussi de notre amour» (Jean-Paul II, 3 mars 1983). Le 24 avril 1988,
le Pape Jean-Paul II a béatifié Francisco Palau, un religieux épris
d'un amour exceptionnel de l'Église.
Francisco Palau
vient au monde le 29 décembre 1811, septième des neuf enfants d'une
famille de paysans catalans d'Aitona (Lérida, Espagne), dans un
contexte politique très difficile. L'Espagne du XIXe siècle, en
effet, a compté, aux dires d'un historien, «cent trente
gouvernements, neuf constitutions, trois rois détrônés, cinq guerres
civiles, des dizaines de gouvernements provisoires et un nombre
quasi incalculable de révolutions». Malgré la dure occupation du
pays par la France napoléonienne, la famille Palau, solidement
chrétienne, poursuit tant bien que mal sa vie paysanne. Francisco
souhaite devenir prêtre. Il est admis au Séminaire de Lérida en
1828. Quatre ans plus tard, il décide d'entrer chez les Carmes. Le
noviciat l'accueille le 23 octobre 1832 et bientôt il prend l'habit
sous le nom de Francisco de Jésus-Marie-Joseph. En dépit des
observances rigoureuses, tout ne va pas pour le mieux dans le
couvent. Certains esprits sont imbus des idées révolutionnaires en
vogue. De plus, les Ordres religieux sont menacés de dissolution par
les forces révolutionnaires. Toutefois, Francisco n'hésite pas à
faire sa profession religieuse le 15 novembre 1833.
Le 25 juillet
1835, une émeute, habilement utilisée contre les religieux, dévaste
le couvent où vit Francisco. Celui-ci parvient à s'enfuir par une
fenêtre et trouve refuge chez une veuve qui l'enferme dans une
armoire. Les émeutiers fouillent la maison. L'un d'eux voulant
ouvrir l'armoire, casse la clé dans la serrure et abandonne la
partie. En mars 1836, le gouvernement supprime les Ordres religieux
et saisit leurs biens, prélude de violences sans fin dans toute
l'Espagne. Dans les années qui suivent, certains radicaux arrivés
provisoirement au pouvoir, interdisent toutes les communications
avec le Saint-Siège. Les prisons se peuplent d'évêques et de
prêtres, et la vente des biens ecclésiastiques s'accélère. En
juillet 1843, toutefois, le parti modéré reprendra le pouvoir et
cherchera à renouer avec Rome.
Francisco pense
renoncer au sacerdoce et choisir l'état de Frère. Fils
d'agriculteur, il a des talents marqués et du goût pour le travail
manuel. Mais ses Supérieurs l'engagent plutôt à se préparer à la
prêtrise. Il reçoit donc l'ordination sacerdotale le 2 avril 1836 et
exerce d'abord son ministère dans la paroisse San Antolín d'Aitona.
Bientôt commence une longue série d'épreuves pour son coeur de
prêtre. En juin 1837, on lui retire les pouvoirs de confesser et de
prêcher; puis en mars 1838 l'autorisation de confesser lui est
rendue mais non celle de prêcher. Il semble, en effet, que sa parole
trop énergique et manquant de diplomatie dérange. Il apprendra à
corriger ce trait de son caractère, mais n'y parviendra jamais
complètement.
Dieu laisse faire
En août 1838, le
gouverneur civil de Lérida l'assigne à demeurer à Aitona en
résidence surveillée, car on l'accuse de faire de la propagande
contre le trône par le biais du confessionnal. Il se retire donc
dans une grotte. La vie de pénitence et de contemplation qu'il y
mène touche le coeur de nombreuses personnes, sans pourtant être du
goût de tout le monde: une nuit, trois individus entrent chez lui,
décidés à le tuer. Quelques mots du Père retournent leur coeur et
ils repartent confessés. Bientôt, las d'une inaction forcée, le Père
Palau part avec son frère et un séminariste vers Tortosa où il
s'adonne à la prédication de missions paroissiales dans la
Catalogne. Puis, comprenant que la situation politique va à nouveau
se dégrader, il décide de s'exiler en France et franchit la
frontière le 21 juillet 1840. Afin de rester indépendant tant du
gouvernement français que de ses compatriotes exilés comme lui, il
se décide à vivre en ermite. Il médite sur la situation de l'Église
en Espagne: prêtres et religieux tués, églises, couvents,
bibliothèques, manuscrits brûlés, oeuvres d'art mutilées, calomnies
les plus abjectes pour discréditer l'Église aux yeux du peuple...
«Comment concevoir que Dieu permette cela? se demande-t-il. La foi
nous enseigne que Jésus-Christ ne manque ni de pouvoir, ni de bon
vouloir... Comment ne calme-t-Il pas la tempête, quand il Lui
suffirait de commander...? C'est un mystère qui me tient occupé en
de profondes méditations... » Et il conclut: «Seule la prière peut
sauver du naufrage l'Église espagnole».
Cependant, les
luttes entre factions rivales qui déchirent l'Espagne s'étendent
jusqu'en France, et, pour y échapper, le Père Palau entreprend un
périple à travers les régions montagneuses de l'Aude et du Tarn. Au
début de 1843, il s'installe avec son frère et quelques jeunes
espagnols dans une grotte au milieu d'un bois touffu, propriété
d'une famille avec laquelle il a lié amitié, dans le diocèse de
Montauban. D'emblée, il obtient la confiance du vicaire général qui
lui donne les pouvoirs de confesser. Il parcourt les campagnes, le
crucifix à la main, et beaucoup viennent à lui, qui pour des besoins
matériels, qui pour des besoins spirituels, tous en quête de
réconfort.
Une ancienne
religieuse clarisse et une jeune fille prennent le Père Palau pour
guide spirituel. Il organise avec elles une petite communauté
contemplative. Bientôt deux autres jeunes filles les rejoignent. Au
printemps de 1846, le Père Palau repasse les Pyrénées et se rend à
Aitona. Toutefois, un an plus tard, il repart pour la France où il
se trouve en butte à de nouvelles contradictions dues à l'attitude
de certains de ses compagnons espagnols restés en France durant son
séjour en Espagne. Il se retire alors dans un endroit encore plus
écarté, où il reprend la vie érémitique. Calomnié devant l'évêque de
Montauban, le Père Palau se défend pour l'honneur du sacerdoce.
Néanmoins, il se soumet aux prescriptions de celui-ci, notamment en
s'abstenant de célébrer la Messe. Le conflit n'ayant pu se résoudre
à l'amiable, il rentre en Espagne en avril 1851.
L' « École de la Vertu »
Le Père se rend
à Lérida, mais on ne veut pas l'y recevoir. Il dirige alors ses pas
vers Barcelone où l'évêque l'accueille paternellement. Il prodigue
ses soins aux jeunes filles qu'il dirige et qu'il nomme les «Soeurs
Tertiaires du Carmel», jusqu'en mars 1852, où les deux petites
communautés qui se sont formées à Lérida et à Aitona sont dissoutes
par ordre du gouverneur civil. Avec son frère Juan et quelques
compagnons, le Père s'installe dans une grotte où ils mènent une vie
pénitente. Mais l'évêque de Barcelone fait appel à lui pour une
nouvelle mission d'évangélisation et lui confie la direction
spirituelle de ses séminaristes. Le Père organise une sorte de
mission continue, un cycle de causeries qui présente chaque dimanche
aux adultes un cours systématique sur la foi catholique. Plus tard,
cette catéchèse s'appellera «École de la Vertu». Son but est de
réconcilier le peuple avec l'Église, la science avec la foi, la
politique avec la religion, de faire passer l'esprit du
christianisme dans les institutions. Constatant le fossé qui grandit
entre forts et faibles, riches et pauvres, le Père veut parvenir à
une véritable insertion du monde ouvrier dans la société.
L'École de la
Vertu est dirigée par un groupe de prêtres et de laïcs avec une
méthode originale qui unit le cours magistral à la participation
active des auditeurs, permettant le dialogue, les questions et
réponses dans les limites du possible, sans oublier des temps de
prière commune. La première partie du programme reprend le traité de
saint Thomas d'Aquin sur les vertus, sous forme de catéchisme. La
seconde partie traite de la doctrine sociale de l'Église: on y
établit les droits de la personne, de la famille et le droit
d'association. Le Père exhorte les hommes à accomplir leurs devoirs
temporels suivant la norme évangélique, et proclame, face aux
accusations d'obscurantisme lancées contre l'Église, que celle-ci
impose aux chrétiens le progrès intellectuel et matériel comme un
devoir. «La vocation propre des laïcs, rappellera le Concile Vatican
II, consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la
gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu... C'est
à eux qu'il revient, d'une manière particulière, d'éclairer et
d'orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont
étroitement unis, de telle sorte qu'elles se fassent et prospèrent
constamment selon le Christ et soient à la louange du Créateur et
Rédempteur» (Lumen gentium, 31).
La paix du Christ
Dans la grande
ville de Barcelone, où commence l'École de la Vertu, la richesse et
la réussite des uns se bâtissent au prix de la misère et de la
souffrance des autres. Le Père Palau explique que la paix et le
bonheur temporel autant que spirituel des peuples exigent que les
droits sociaux soient reconnus, acceptés, respectés et protégés. «La
vie chrétienne ne s'exprime pas uniquement dans les vertus
personnelles, mais également dans les vertus sociales et
politiques», rappelait le Pape Benoît XVI, le 13 mai 2007. Sans
adhésion des coeurs au commandement d'amour du Christ, pense avec
raison le Père Palau, il n'y aura jamais ici-bas de paix, de
justice, de fraternité, de liberté vraies ni durables. Son succès
est imposant: on en arrive à réunir deux mille personnes dans
l'église où, le dimanche après-midi, on parle d'amour et de justice
à l'ouvrier et à l'employeur, où on prêche la vérité à l'élève et au
professeur, où le médecin et l'avocat vérifient l'harmonie entre
science et révélation. Bien des esprits troublés retrouvent la paix.
Les élèves de
l'École de la Vertu appartiennent en grande partie à la classe
ouvrière et certains gouvernants affectent de croire qu'on y prône
des idées socialistes jugées dangereuses. En 1854, des grèves
d'ouvriers éclatent à Barcelone. L'autorité militaire décrète la
suppression de l'École de la Vertu, accusée d'avoir eu un grand rôle
dans ces grèves. Les ouvriers ainsi que les responsables de la
Société des Tisserands se font les défenseurs de l'École. Malgré
cela, le Gouverneur décrète, le 6 avril, l'exil immédiat du Père
Palau sur l'île d'Ibiza (Baléares). Le Père pourra écrire: «Si,
comme nous nous sommes abstenus de nous mêler de politique, la
politique avait laissé intacte la religion, l'École de la Vertu
aurait poursuivi pacifiquement sa route». Le Pape Benoît XVI dira:
«L'Église est avocate de la justice et des pauvres, précisément en
ne s'identifiant pas avec les politiques, ni avec les intérêts de
partis. C'est dans l'indépendance qu'elle peut enseigner les grands
critères et les valeurs auxquels il ne faut pas déroger, orienter
les consciences et offrir une option de vie qui aille bien au-delà
du cadre politique. Former les consciences, prendre la défense de la
justice et de la vérité, éduquer aux vertus individuelles et
politiques, telle est la vocation fondamentale de l'Église dans ce
domaine» (13 mai 2007).
« Je contemplais »
À Ibiza, le Père
Palau souffre profondément de son inaction forcée. Avec deux de ses
fidèles compagnons, il transforme le terrain inculte qui lui a été
donné en un jardin potager et un verger. Sensible à toutes les
beautés artistiques, le Père Palau se fait souvent poète. «En toutes
les saisons, écrit-il, j'ouvrais les fenêtres, et de ma longue-vue,
je contemplais tout ce qu'il y avait de beau en hiver, au printemps,
en été et à l'automne». Il prodigue ses soins spirituels à la
population de l'île. Durant cet exil, sa vie spirituelle
s'approfondit. Il comprend plus profondément le lien qui existe
entre amour de Dieu et amour du prochain: «Si l'amour cherche Dieu
seulement, croyant que Dieu, sans la relation au prochain, suffit,
il en reste là, il fait du surplace; et s'il n'en sortait pas pour
se répandre sur le prochain, l'égoïsme spirituel le consumerait et
le perdrait».
Des décrets
d'amnistie sont promulgués en 1856-1857: le Père espère pouvoir en
bénéficier mais on ne veut pas les lui appliquer. Il lui faut
attendre l'amnistie générale du 1er mai 1860. Le 30 août suivant, un
journal catholique fait savoir aux Barcelonais que «le gouvernement
a accueilli favorablement les justes réclamations du prêtre sage et
vertueux (le Père Palau) qui, depuis si longtemps, supportait les
conséquences d'une persécution injuste; les hauts tribunaux de la
nation ont rendu entière justice à son innocence».
À la fin de
1860, Francisco Palau est gratifié d'une vision mystique de l'Église
figurée par une jeune fille. Vierge pure et Mère féconde, l'Église
est pèlerine ici-bas et elle apparaît pécheresse en ses membres
faillibles. L'ivraie du péché s'y trouve mêlée au bon grain de
l'Évangile jusqu'à la fin des temps (cf. Catéchisme de l'Église
Catholique, CEC, 827). Conscient de cette vérité, le cardinal
Ratzinger proposait, le Vendredi Saint, 25 mars 2005, la prière
suivante: «Souvent, Seigneur, ton Église nous semble une barque
prête à couler, une barque qui prend l'eau de toute part. Et dans
ton champ, nous voyons plus d'ivraie que de bon grain. Les vêtements
et le visage si sales de ton Église nous effraient. Mais c'est
nous-mêmes qui les salissons! C'est nous-mêmes qui te trahissons
chaque fois, après toutes nos belles paroles et nos beaux gestes.
Prends pitié de ton Église: en elle aussi, Adam chute toujours de
nouveau. Par notre chute, nous te traînons à terre, et Satan s'en
réjouit, parce qu'il espère que tu ne pourras plus te relever de
cette chute; il espère que toi, ayant été entraîné dans la chute de
ton Église, tu resteras à terre, vaincu. Mais toi, tu te relèveras.
Tu t'es relevé, tu es ressuscité et tu peux aussi nous relever.
Sauve ton Église et sanctifie-la. Sauve-nous tous et sanctifie-nous»
(Chemin de Croix, neuvième station).
Passionné pour l'Église
Toutefois,
malgré les faiblesses de ses membres, l'Église est sainte en
elle-même: «L'Église est sainte parce que le Dieu très saint en est
l'auteur. Le Christ s'est livré lui-même pour elle, afin de la
sanctifier et de la rendre sanctifiante. L'Esprit-Saint la vivifie
par la charité. En elle réside la plénitude des moyens du Salut. La
sainteté est la vocation de chacun de ses membres et le but de toute
son action. L'Église compte en son sein la Vierge Marie et
d'innombrables saints, qui sont ses modèles et ses intercesseurs. La
sainteté de l'Église est la source de la sanctification pour ses
fils, qui, sur la terre, se reconnaissent tous pécheurs et qui ont
toujours besoin de se convertir et de se purifier» (Compendium du
Catéchisme de l'Église Catholique, 165). Dans la défense de
l'Église, le Père Palau apparaît passionné: il est pressé par son
amour, son désir de servir cette Église faite de pierres vivantes,
ses frères. Il dira, plus tard, que tous ses temps d'oraison, toutes
ses activités apostoliques ou contemplatives, ont eu une seule fin:
l'unir dans la foi, l'espérance et l'amour avec l'Église. Celle-ci
est pour lui le Christ «contemplé et aimé non comme un seul
individu, mais comme la tête d'un corps, un tout», un mystère à
vivre plus qu'une vérité à croire, l'unique instrument du Salut.
L'union avec l'Église est le moyen le plus intime de la communion
avec le Christ qui se réalise d'une manière privilégiée dans
l'Eucharistie.
«Je dois aller
d'un bout à l'autre de l'Espagne et travailler de toutes mes forces
au salut des âmes, là où s'ouvrira à moi un chemin», écrit le Père
Palau. Dès lors son apostolat se diversifie, redevient fébrile,
intense, sans qu'il néglige pour autant la prière solitaire et la
pénitence. Analysant avec lucidité la situation de Barcelone, il
constate que l'implantation industrielle attire des milliers de
personnes dont les besoins matériels et spirituels sont immenses. Il
établit partout des groupes de chrétiens actifs qui, avec leurs
curés, pourront assurer des conférences dominicales pour les jeunes,
réunions qui les protègent du désoeuvrement et des distractions
dangereuses. Il lutte contre l'ignorance, la superstition, les
déviations du sentiment religieux. Toutefois, il n'oublie pas la
Congrégation qu'il a entrepris de fonder, ses Tertiaires du Carmel,
Frères et Soeurs. La branche masculine a été fondée en 1860 à
Majorque; peu après, en février 1861, les Soeurs s'installent à
Minorque. Sans négliger l'aspect contemplatif, la Congrégation prend
en charge des écoles, puis l'assistance aux malades à domicile ou en
hôpital. L'établissement de Minorque toutefois ne dure pas; en
revanche, un champ d'expansion s'ouvre en Aragon et en Catalogne.
En 1865, des
missions à Ibiza et dans le diocèse de Barcelone absorbent le Père
Palau. En décembre 1866, il se rend à Rome pour obtenir la
reconnaissance officielle de la Congrégation des Tertiaires du
Carmel. Dès le 8 janvier 1867, il obtient le droit de recevoir les
voeux religieux de ses fils et filles spirituels, avec le
consentement préalable de l'évêque du lieu. Il écrit, cette même
année, les statuts de ceux qu'il appelle les Frères Tertiaires de la
Vierge du Carmel. Ces Frères, alors au nombre de vingt-six, sont
répartis en six maisons. Cette fondation masculine, à laquelle le
Père tient beaucoup, durera jusqu'à la guerre civile de 1936, où
tous ses membres travaillant dans la péninsule, sauf un, seront
massacrés dès les premiers troubles. Quant aux Soeurs issues de la
fondation primitive, elles se constitueront finalement en deux
Congrégations féminines qui essaimeront sur quatre continents: les
Soeurs Carmélites Missionnaires Thérésiennes, et les Carmélites
Missionnaires.
En 1868, le Père
lance un hebdomadaire, «El Ermitaño». Il y montre un vrai talent de
polémiste, surtout lorsqu'il s'agit de défendre l'Église, car alors
les traits percutants fusent comme naturellement sous sa plume. Son
sens de l'humour lui permet de sourire de ses propres aventures et
redonne courage à ses correspondants déconcertés par la tournure des
événements. À la suite de la révolution de septembre 1868, une
nouvelle vague de persécutions déferle sur l'Espagne. Le Père Palau
est emprisonné, à la fin d'octobre 1870, avec plusieurs de ses
Frères et Soeurs. Après deux mois de prison préventive, il est
libéré, mais il faudra encore un an avant que le juge ne reconnaisse
son innocence.
« Thérèse, c'est l'heure ! »
À la fin de sa
vie, le Père voyage beaucoup, angoissé à la pensée de laisser son
oeuvre inachevée, car plusieurs fondations sont en préparation, mais
il manque de moyens financiers et de personnel. D'autre part,
certains de ses compagnons l'abandonnent et sèment le trouble par
leurs critiques. Il installe à Tarragone une maison centrale d'où il
pourra diriger l'ensemble de l'oeuvre. Le 14 février 1872, il publie
un livret contenant les Règles et Constitutions de l'Ordre Tertiaire
des Carmes Déchaux. À cette même époque, le Père Palau accompagne
trois de ses Soeurs à Calasanz, en Aragon, où sévit une épidémie
meurtrière. Leur dévouement auprès des malades touche parfois à
l'héroïsme. Le Père rentre à Tarragone, épuisé par cette activité
charitable. Il recommande une dernière fois l'Église à ceux qui
l'entourent: «Priez pour le triomphe de l'Église, unissant vos
supplications à celles de saint Joseph, car nous en faisons notre
médiateur... Jamais je ne me suis écarté de l'Église dans le plus
petit détail; dans mes opinions, j'ai toujours soumis mon jugement
sans avoir d'autre intérêt que la gloire de Dieu». Toute la
communauté étant réunie dans sa chambre, il dit: «Agenouillez-vous,
que je vous bénisse!» Levant le bras droit, il bénit ses enfants et
ajoute, à l'adresse de sainte Thérèse d'Avila: «Thérèse, c'est
l'heure!» et, le bras levé, il rend son dernier soupir.
Le Père Palau a
toujours eu pour la Vierge Marie une tendresse filiale. En 1864,
celle-ci s'est révélée à lui comme la figure la plus parfaite de
l'Église. C'est ainsi qu'il l'a présentée aux fidèles. «En la
personne de la bienheureuse Vierge, l'Église atteint déjà à la
perfection qui la fait sans tache ni ride. Les fidèles du Christ,
eux, sont encore tendus dans leur effort pour croître en sainteté
par la victoire sur le péché: c'est pourquoi ils lèvent leurs yeux
vers Marie » (CEC, 829). Demandons à Notre-Dame de nous
obtenir un amour indéfectible de l'Église.
Cf. Le
bienheureux Francisco Palau,
Armand Duval, éd. F.-X. de Guibert, 2003.
Dom Antoine
Marie osb,
abbé de Saint-Joseph de Clairval
Pour publier la lettre de l'Abbaye Saint-Joseph de Clairval dans une
revue, journal, etc. ou pour la mettre sur un site internet ou une
home page, une autorisation est nécessaire. Elle doit nous être
demandée
par email ou à travers
http://www.clairval.com. |
