|
Esther Blondin, en religion « Sœur Marie-Anne », naît à
Terrebonne
(Québec, Canada), le 18 avril 1809, dans une famille d'agriculteurs profondément
chrétiens. Elle hérite de sa mère une piété centrée sur la Providence
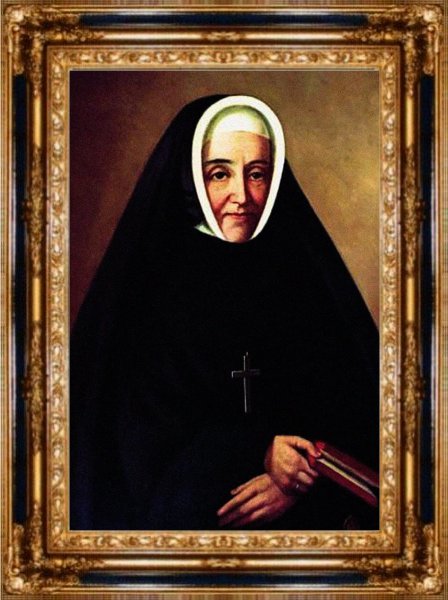 et
l'Eucharistie et, de son père, une foi solide et une grande patience dans la
souffrance. Esther et sa famille sont victimes de l'analphabétisme qui règne
dans les milieux canadiens-français du XIXe siècle. À 22 ans, elle s'engage
comme domestique au couvent des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame,
nouvellement arrivées dans son village. Un an plus tard, elle s'y inscrit comme
pensionnaire pour apprendre à lire et à écrire. On la retrouve ensuite au
noviciat de cette même Congrégation qu'elle doit cependant quitter, à cause
d'une santé trop fragile. et
l'Eucharistie et, de son père, une foi solide et une grande patience dans la
souffrance. Esther et sa famille sont victimes de l'analphabétisme qui règne
dans les milieux canadiens-français du XIXe siècle. À 22 ans, elle s'engage
comme domestique au couvent des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame,
nouvellement arrivées dans son village. Un an plus tard, elle s'y inscrit comme
pensionnaire pour apprendre à lire et à écrire. On la retrouve ensuite au
noviciat de cette même Congrégation qu'elle doit cependant quitter, à cause
d'une santé trop fragile.
En 1833, Esther devient institutrice à l'école du village de Vaudreuil. C'est là
qu'elle découvre une des causes de l'analphabétisme ambiant: un règlement d'Église,
qui interdit aux femmes d'enseigner aux garçons, et aux hommes d'enseigner aux
filles. Ne pouvant financer deux écoles paroissiales, les curés choisissent
souvent de n'en tenir aucune. Et les jeunes croupissent dans l'ignorance,
incapables de suivre le catéchisme pour faire leur première communion. En 1848,
avec l'audace du prophète que meut un appel irrésistible de l'Esprit, Esther
soumet à son évêque, Monseigneur Ignace Bourget, le projet qu'elle nourrit
depuis longtemps: celui de fonder une Congrégation religieuse «pour l'éducation
des enfants pauvres des campagnes dans des écoles mixtes». Le projet est
novateur pour l'époque! Il paraît même «téméraire et subversif de l'ordre
établi». Mais, puisque l'État favorise ce genre d'écoles, l'évêque autorise un
modeste essai pour éviter un plus grand mal.
La Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne est fondée à Vaudreuil, le 8 septembre
1850 et Esther - désormais appelée «Mère Marie-Anne» - en devient la première
supérieure. Le recrutement rapide de la jeune Congrégation requiert très tôt un
déménagement. À l'été de 1853, l'évêque Bourget transfère la Maison mère à
Saint-Jacques-de-l'Achigan. Le nouvel aumônier, l'abbé Louis-Adolphe Maréchal,
s'ingère de façon abusive dans la vie interne de la communauté. En l'absence de
la Fondatrice, il change le prix de la pension des élèves. Et, quand il doit lui
même s'absenter, il demande aux sœurs d'attendre son retour pour se confesser.
Après une année de conflit entre l'aumônier et la supérieure, soucieuse de
protéger les droits de ses sœurs, l'évêque Bourget croit trouver une solution:
le 18 août 1854, il demande à Mère Marie-Anne de « se déposer ». Il convoque
des élections et exige de Mère Marie-Anne de « ne plus accepter le mandat de
supérieure, si ses sœurs veulent la réélire ». Privée du droit que lui donne la
Règle de la Communauté d'être réélue, Mère Marie-Anne obéit à son évêque qu'elle
considère comme l'instrument de la Volonté de Dieu sur elle. Et elle « bénit
mille fois la divine Providence de la conduite toute maternelle qu'elle tient à
son égard, en la faisant passer par la voie des tribulations et des croix ».
Nommée alors directrice au Couvent de Sainte-Geneviève, Mère Marie-Anne devient
une cible de harcèlement de la part des nouvelles autorités de la Maison mère,
subjuguées par le despotisme de l'aumônier Maréchal. Sous prétexte de mauvaise
administration, on la ramène à la Maison mère en 1858, avec la consigne
épiscopale de « prendre les moyens pour qu'elle ne nuise à personne ». Depuis
cette nouvelle destitution et jusqu'à sa mort, elle est tenue à l'écart de toute
responsabilité administrative. On l'écarte même des délibérations du conseil
général où les élections de 1872 et de 1878 l'ont réélue. Affectée aux plus
obscurs travaux de la buanderie et de la repasserie, elle mène une vie de
renoncement total, qui assure la croissance de sa Congrégation. C'est là le
paradoxe d'une influence qu'on a voulu neutraliser: dans les caves obscures de
la repasserie de la Maison mère, de nombreuses générations de novices recevront
de la Fondatrice l'exemple d'une vie d'obéissance, d'humilité et de charité
héroïques. À une novice qui lui demandait un jour pourquoi elle, la Fondatrice,
était maintenue dans de si modestes emplois, elle s'est contentée de répondre
avec douceur : « Plus un arbre enfonce ses racines profondément dans le sol,
plus il a de chances de grandir et de porter du fruit ».
L'attitude de Mère Marie-Anne, face aux situations d'injustice dont elle fut
victime, nous permet de découvrir le sens évangélique qu'elle a toujours donné
aux événements de sa vie. Comme le Christ passionné pour la Gloire de son Père,
elle n'a cherché en tout que « la Gloire de Dieu » qu'elle a donnée pour fin à
sa communauté. « Faire connaître le bon Dieu aux jeunes qui n'avaient pas le
bonheur de le connaître », c'était pour elle un moyen privilégié de travailler à
la Gloire de Dieu. Dépouillée de ses droits les plus légitimes, spoliée de sa
correspondance personnelle avec son évêque, elle cède tout, sans résistance,
attendant de Dieu le dénouement de tout, sachant que « dans sa Sagesse, il saura
discerner le vrai du faux et récompenser chacun selon ses œuvres ».
Empêchée de se laisser appeler « mère » par les autorités qui lui ont succédé,
Mère Marie-Anne ne s'attache pas jalousement à son titre de Fondatrice ; elle
accepte plutôt l'anéantissement, comme Jésus, « son Amour crucifié », pour que
vive sa communauté. Elle ne renonce pas pour autant à sa mission de mère
spirituelle de sa Congrégation; elle s'offre à Dieu « pour expier tout le
mal qui s'est commis dans la communauté » ; et elle demande tous les jours à
sainte Anne, « pour ses filles spirituelles, les vertus nécessaires aux
éducatrices chrétiennes ».
Comme tout prophète investi d'une mission de salut pour les siens, Mère
Marie-Anne a vécu la persécution, en pardonnant sans restriction; car elle
était convaincue qu'il y a « plus de bonheur à pardonner qu'à se venger ». Ce
pardon évangélique était pour elle le garant de « la paix de l'âme qu'elle
tenait pour le bien le plus précieux » ; et elle en donna un ultime témoignage
sur son lit d'agonie, en demandant à sa supérieure de faire venir l'abbé
Maréchal « pour l'édification des sœurs ».
Sentant venir sa fin, Mère Marie-Anne lègue à ses filles, en guise de testament
spirituel, ces quelques mots qui résument bien toute sa vie : « Que
l'Eucharistie et l'abandon à la Volonté de Dieu soient votre ciel sur la
terre ». Puis elle s'éteint paisiblement à la Maison mère de Lachine, le 2
janvier 1890, « heureuse de s'en aller chez le bon Dieu » qu'elle avait servi
toute sa vie. |
